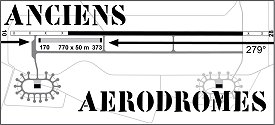Villacoublay : Hangar Destrem (constructeur Champeau)
Sep 02
2.1 - Sans Type béton, bow-string, Champeau, Destrem, Hangar, Villacoublay Commentaires fermés sur Villacoublay : Hangar Destrem (constructeur Champeau)
par Guilhem Labeeuw

Le hangar “Destrem”, construit vers 1922 pour le Service Technique de l’Aéronautique de Villacoublay se situait le long de la route de Versailles RN186 (actuelle A86). Conçu presqu’entièrement en béton armé, ce hangar réalisé par l’entreprise Champeau Fils a été remarqué pour son caractère novateur et audacieux, notamment en raison de sa charpente constituée de voûtes en béton de type bow-string situées à l’extérieur. Achevé quelques mois avant le hangar Guynemer, (entreprise Champeau et Fils), il fut ensuite baptisé “Destrem” en hommage au capitaine de corvette Destrem décédé accidentellement à Guyancourt, en novembre 1923. Contrairement au Guynemer, le Destrem fut complétement détruit lors des bombardements de 1944.

Hangar Destrem, constructeur Champeau. Source : Le Génie civil
Introduction : Le Service Technique de l’Aéronautique
Parmi les occupants du terrain de Villacoublay au début du siècle précédent, se trouvait une Section des Essais en vol dépendant du Service Technique de l’Aéronautique (STA) dont les bureaux siégeaient à Issy-les-Moulineaux, 2 rue Jeanne d’Arc. Créée en 1915, le rôle de cette section était de contrôler les performances des avions français à livrer à l’armée. Au sortir de la guerre, les installations du STA situées le long de la route de Versailles, à l’est de hangars des établissements Breguet ne se limitaient pourtant qu’à quelques hangars en structures bois, sans guère d’ateliers.
Un vaste programme de rénovation et de construction de hangars et bâtiments techniques est alors entrepris début 1920, afin de donner les moyens adéquats aux personnels de la section des essais et faisant de Villacoublay l’aérodrome attitré du Service Technique de l’Aéronautique. Les trois hangars seront dénommés Gonidec, Destrem et Guynemer. Il n’en reste qu’un seul à ce jour, le Guynemer.

Vue des installations de la section des essais en vol du Service Technique de l’Aéronautique (vers 1923). Source : L’Aéronautique. 1923-05

Vue des installations de la section des essais en vol du Service Technique de l’Aéronautique en 1923. Source : L’Aéronautique. 1923-05
Le hangar Destrem, dont il est question ici (bât. b “Champeau”, 100 m de long par 35 m de large et 10m de hauteur libre) est visible au centre de la photo ci-dessus. C’est le premier construit par l’entreprise Champeau et Fils à Villacoublay. Il est facilement reconnaissable par sa structure de charpente en poutres en béton armé de type bow-string en extérieur.

Les 3 hangars du Service Technique de l’Aéronautique, avec de gauche à droite, le hangar Gonidec (Dubois); le hangar Destrem au milieu et le Guynemer au fond (vers 1930). Source / DR : musée Nicéphore Niépce, Ville de Chalon-sur-Saône
Programme du concours
Le programme lancé par le Service Technique de l’Aéronautique (Nota 2A : date non retrouvée à ce jour) prévoyait une surface couverte de 3500 m2, avec deux grandes portes, devant dégager chacune un passage libre de 45 m de large par 10 m de haut. Ces portes devaient être équipées d’un système d’ouverture motorisé avec manœuvre de secours manuelle.
L’intérieur du hangar devait être chauffé et muni d’installations électriques adaptées à l’usage du hangar. Des palans de manœuvres étaient également prévus ainsi qu’un poste de secours contre l’incendie. L’eau de pluie devait être récupérée en toiture pour alimenter les radiateurs des avions.
C’est l’entreprise Champeau fils qui réalisa ce hangar entre 1920 [2] et fin 1922 (Nota 2A : les sources s’accordent sur la date de fin de travaux). Quelques mois plus tard, cette même entreprise débutait la construction du hangar Guynemer ainsi que deux autres bâtiments en briques (n° f et g du plan ci-dessus) achevés fin 1923. Entreprise vraisemblablement peu connue à l’époque par rapport aux entreprises telles que Limousin ou Boussiron, elle ne semble pas particulièrement spécialisée dans la construction de hangar en béton : dans l’annuaire du commerce Didot-Bottin de 1921 et années suivantes, l’entreprise Champeau Fils est répertoriée en tant qu’entrepreneur de travaux publics domiciliés dans le 15ème arrondissement, 8 rue Jean-Naudin. Un maçon dénommé Champeau est référencé à la même adresse (8 passage Daudin) dès 1909. Les installations du n°8 semblent très modestes mais les archives du Moniteur des TP nous apprennent que cette rue Daudin regroupait plusieurs entrepreneurs de travaux publics.
Nota 2A : Comme pour le hangar Guynemer, nous sommes toujours à la recherche des archives de conception de ces deux hangars pour mieux comprendre les différents intervenants qui ont participé à leur réalisation.

L’ossature du hangar est achevée mi-1922. source : Le Génie civil
Description générale du hangar Destrem [1]
Le hangar comporte deux travées accolées, ayant chacune pour dimension 50 m de longueur par 35 m de profondeur et 10 m de hauteur sous-plafond. Il est constitué par :
- Un long pan (i.e une façade) arrière le long de la N186 de 100 m de longueur, constituée de remplissage en maçonneries et d’ouvertures vitrées ;
- A chaque extrémité de ce long pan, et en retour, un pignon constitué de poteaux béton et remplissage en maçonneries avec quelques ouvertures vitrées, de 35 m de profondeur ;
- Au centre, une file de 5 poteaux en béton dans l’axe de l’ouvrage, séparant les deux travées. En l’absence de maçonneries entre les poteaux, il est possible de circuler entre les deux travées
- Un long pan avant, constitué par des portes métalliques coulissantes laissant, de part et d’autre de l’axe de l’ouvrage, une largeur libre de passage de 45 m ; Un dallage en béton devant le hangar sera réalisé quelques années plus tard ;
- A chaque extrémité de ce long pan avant, se trouve un abri couvert où se rangent les portes. Un auvent métallique continu permet également de protéger les rails de suspension des portes sur toute la longueur de la façade ;
- Un plafond suspendu à la charpente, constitué de briques creuses Poyet
- Enfin, la charpente et la couverture de l’ensemble, entièrement en béton armé.

Plan du hangar. Source : Le Génie civil
Côté installations techniques le hangar est chauffé par un groupe de chaudières Astra située en sous-sol et assurant le chauffage par la vapeur des deux travées. Les dispositifs d’éclairage suspendu peuvent être réglés à la hauteur voulue. Le hangar est également équipé d’accessoires destiné à la manutention des pièces d’avion : Sur l’entrait des arcs et pour chaque travée, sont fixés deux rails pour chariots porte-palans différentiels facilitant, du sol, la manœuvre des moteurs et pièces lourdes à manutentionner. La travée de gauche comporte, au niveau du sol, l’installation de deux ponts à bascule de 32 tonnes chacun.

Vue intérieure en 1923. Source : le Génie civil
Une charpente et une couverture innovantes :
Dans ce projet novateur, on s’aperçoit que la charpente du hangar n’est pas située à l’intérieur du volume, comme habituellement pour supporter une couverture mais située au dessus, à l’extérieur. Cette disposition, peu commune à l’époque s’explique par la volonté du concepteur de réduire la hauteur d’implantation de la couverture, d’une part pour réduire les effets (surfaciques) du vent sur le hangar (la prise au vent) afin d’éviter de devoir mettre des jambes de forces sur les poteaux et d’autre part pour réduire le volume intérieur chauffé, la couverture étant placée au point le plus optimal possible, juste au dessus du plafond (cf. photo ci-dessus, l’on distingue des éléments de plafonds) aligné avec le haut des grandes portes.
Pour répondre à cet objectif, le choix a été fait d’utiliser la technique fréquemment utilisée en ouvrages d’art, à savoir un arc de type bow-string (arc tendu). Là ce sont des poutres en béton armé de 50 m de portée dont la membrure supérieure adopte une forme d’arc qui ont été utilisées, espacées de 5,80 m entre elles et contreventées entre elles par des pannes – entretoises en béton. Chaque poutre repose à ses extrémités sur les poteaux du pignon d’une part et sur ceux de la file médiane à l’intérieur d’autre part. Les appuis sont de type rotules, dont un est fixe et l’autre constitué d’un appui à chariot de dilatation. A noter que la poutre bow-string située au droit des grandes portes reprend les efforts de ces dernières pour moitié, expliquant les renforts visibles sur la photo intérieure.

Vue perspective sur la charpente et la toiture. Source : Le Génie civil
La couverture quant à elle était réalisée par des éléments classiques à deux pentes, dont le point bas (la sablière) reposait sur la membrure inférieure (l’entrait) de la poutre bow-string adjacente. Cette couverture est constituée d’une charpente en fermettes métalliques recouvertes de tuiles en ciment armé. Les tuiles en ciment armé sont utilisées fréquemment pour les hangars, comme les hangars Piketty à Villacoublay, le hangar à dirigeables d’Ecausseville ou encore les hangars Lossier au Bourget.
Des chéneaux, peu visibles sur le croquis mais situés de part et d’autre de la membrure inférieure servaient servir de récupération d’eau comme indiqué dans le programme de construction, même si leur positionnement a dû nécessiter une adaptation des poutres bow-string et constituer une difficulté de réalisation avec probablement des problèmes d’étanchéité fréquents.
Enfin, le plafond suspendu à l’intérieur, réalisé en briques Poyet permet :
- d’assurer une stabilité à l’ensemble, en participant par sa rigidité au contreventement global de la charpente
- de résister aux appels d’air et autres effets du vent lorsque les portes des hangars sont ouvertes ou dans les cas où les hélices des avions seraient en fonctionnement à l’intérieur du hangar
- de limiter le volume chauffé au strict minimum

Coupe transversale du hangar. Source : Le Génie civil
Le système des portes coulissantes
Autre témoin de l’ambition du programme de ce concours de hangar, les deux grandes portes qui devaient être motorisées. Si à l’époque, des versions de portes motorisées existaient bel et bien (cf. les portes de hangar type américain avec des contrepoids extérieurs ou le hangar d’Ecausseville), la version ici que livrent les entreprises Champeau reste à la fois ambitieuse pour le début des années 1920 et relativement simple d’entretien. C’est d’ailleurs durant cette décennie que vont se développer différents systèmes de portes de hangars, comme en témoignent les nombreux brevets. Dans le cas du hangar Destrem, nous n’avons pas encore retrouvé quelle entreprise spécialisée a pu réaliser ces portes pour le compte des entreprises Champeau.
Les deux grandes portes sont constituées chacune de 4 vantaux (i.e panneaux) roulants au sols et guidés en partie haute, disposés de manière décalée de l’épaisseur d’un vantail. Les 4 vantaux d’une porte se rangent dans un abri ouvert, à l’extrémité du hangar. Chaque vantail est constitué d’une ossature métallique recouverte de tôle ondulée. En partie haute, les portes sont suspendues à la charpente via un profilé métallique formant rail de guidage, à l’aide de deux galets horizontaux et d’un dispositif d’anti-décrochement. En partie basse, les vantaux sont reliés à des galets verticaux circulant dans des rails de guidage et actionnés par un système électrique faisant fonctionner des treuils par câbles et poulies de renvoi.
La manœuvre des deux portes se fait depuis une cabine située à l’intérieur de chacune des deux travées. La cabine permet à un opérateur d’actionner un treuil qui met en mouvement les poulies de deux vantaux. Un deuxième treuil actionne les deux autres vantaux et un système de débrayage permet de gérer l’ouverture complète des 4 vantaux. Un dispositif manuel de secours permet de faire fonctionner les treuils de façon manuelle, permettant d’ouvrir les portes en une dizaine de minutes. Les chambres où se situent les galets, poulies et câbles restent accessibles pour la maintenance.

Détail de la chambre des treuils actionnant les chariots des panneaux de porte. Source : Le Génie civil
Autres réalisations du même type
A l’époque du début des années ce hangar présentait une innovation majeure avec sa charpente extérieure en poutres bow-string. Les entreprises Limousin avec Freyssinet s’en inspireront assurément pour réaliser à peine deux ans plus tard un hangar du même type à Chartres en 1924, dont la réalisation par les entreprises Limousin est attestée dans l’ouvrage de S. Giedion [3] et sans nul doute un autre à Villacoublay vers 1925 (même si ce dernier n’est pas référencé par F. Ordonez [4], il est quasiment identique à celui de Chartes et N. Nogue lui attribue également cette réalisation [5]). La conception de ces hangars reprend le principe des poutres à bow-string et des toitures surbaissées, mais en donnant une forme plus esthétique aux poutres : plus élancées que celles de Champeau, avec des suspentes moins massives, Freyssinet remplace également les couvertures à deux pentes par des coques deux fois plus larges, réduisant ainsi la trame des poutres bow-string.

A gauche, les hangars doubles à poutre bow-string de Chartres (1924) et droite celui de Villacoublay (vers 1925), tous deux construits par Limousin et Freyssinet. Sources : S. Giedion [3] et l’Architecture d’Aujourd’hui, 1936
L’historienne Marie-Jeanne Dumont, dans son mémoire sur l’architecture aéronautique [6] rapproche ces productions de hangars à poutres bow-string à ceux de la base aérienne de Meknès (hangar toujours existant) ou au hangar triple construit sur la base d’hydravions de Berre, par la société Dumez en 1934. Ces dernières productions, postérieures reprennent le principe mais diffèrent par leur forme des poutres ou des tirants.
Malgré ces quelques exemples, ce type de hangar ne va pas se généraliser, et l’exemple des hangars Lossier au Bourget dans le milieu des années 20 montre que les constructeurs reviennent vite à des couvertures situées au dessus de la charpente.
Illustrations complémentaires du hangar Destrem (Champeau Fils)

Le hangar Destrem (détruit en 1944). source : IGN, 1922

Hangar portes fermées (1923). Source : Le Génie civil

7 juillet 1923. Source : La Technique aéronautique, 1923

Vue aérienne en 1926. Source : IGN

A droite au fond le hangar, et ensuite les deux bâtiments en briques construits par Champeau. DR

Devant le hangar, portes fermées, vers 1930. DR
Sources :
- photothèque IGN
- Revue L’Aéronautique. Mai 1923
- Revue Le Génie civil. 1922-07-15
- Revue La Technique aéronautique : revue internationale des sciences appliquées à la locomotion aérienne. 1923-02-15
- [1] Revue Le Génie civil. 1923-03-10
- [2] Revue L’Illustration économique et financière. 15 aout 1925
- Annales des ponts et chaussées, 1er semestre 1923
- [3] Siegfried Giedion, Bauen in Frankreich, Bauen in Eisen, Bauen in Eisenbeton, Klinkhardt & Biermann, Leipzig 1928
- Revue L’Architecture d’Aujourd’hui, 1936, n°11
- [6] Marie-Jeanne Dumont, Architecture de L’aéronautique En France 1900 1940, 1988 (non publié)
- [5] Nicolas Nogue, L’architecture aéronautique en France, Docomomo France, octobre 2006 (non publié)
- [4] José A. Fernadez Ordonez, Eugène Freyssinet, Ed. du Linteau, 2012
 RSS
RSS